Dans un ouvrage iconoclaste, le spécialiste de l’histoire des religions Daniel Dubuisson montre comment l’aspect universel du concept de « religion » masque son appartenance à un univers de pensée résolument occidental.
Les religions ne sont en rien un phénomène universel, seulement une invention occidentale plaquée sur le reste du monde. Voilà le cœur du propos stimulant de Daniel Dubuisson dans L’Invention des religions* (CNRS Editions), publié à la mi-octobre et dont la version anglaise (parue en 2019 chez Equinox Publishing) vient de se voir décerner un prix d’excellence par l’American Academy of Religion (AAR).
Avec ce nouvel ouvrage, le directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui dialogue depuis une vingtaine d’années avec la branche critique des religious studies (« études religieuses ») américaines, cherche à introduire ce courant méconnu en France pour déconstruire les présupposés dominants dans l’analyse des religions.
Comment votre travail de recherche vous a-t-il conduit à la déconstruction du concept de religion ?
Le point de départ a été ma découverte inattendue de la branche critique des religious studies américaines. Je me suis lancé, au cours des années 1990, dans une anthologie visant à regrouper un grand nombre de textes occidentaux traitant des religions en général ; ce projet aboutira au Dictionnaire des grands thèmes de l’histoire des religions. De Pythagore à Lévi-Strauss (Editions Complexe, 2004), portant sur six cents textes de deux cents auteurs.
C’est au cours de ce travail que l’intuition des problèmes posés par la notion de religion m’est venue. Je me suis donc lancé, en parallèle de cette anthologie, dans un livre ayant pour vocation d’en être le pendant théorique. Ce sera L’Occident et la Religion. Mythes, science et idéologie, paru en 1998 (Editions Complexe).
J’y développais l’idée que le concept de religion est une invention chrétienne qui n’est pertinente que dans un cadre occidental : c’est donc par un processus d’acculturation que nous avons construit des religions dans les autres cultures. Un collègue américain, à qui j’avais envoyé un exemplaire de ce livre, a été très enthousiaste et a œuvré pour le faire traduire. Cette version, parue en 2004 aux Etats-Unis, a eu beaucoup plus d’échos là-bas que la version française chez nous.
C’est ainsi que j’ai découvert, au tournant des années 2000, que des universitaires américains travaillaient sur ces mêmes idées, mais de façon massive. Mon travail, isolé en France, s’est alors retrouvé associé à un puissant courant d’études anglo-saxonnes – ce qui explique que ma notoriété, bien que modeste, soit plus importante de ce côté-là de l’Atlantique.
En quoi consistent justement ces « religious studies » méconnues en France, et que vous cherchez à faire connaître dans « L’Invention des religions » ?
La situation aux Etats-Unis n’a rien à voir avec la France. Chaque université, ou presque, compte un département d’études religieuses. De ce fait, les effectifs de chercheurs travaillant sur ces sujets sont très importants. Les polémiques et controverses y sont extrêmement vives, et se structurent essentiellement à travers deux grandes institutions s’opposant frontalement.
D’un côté, l’American Academy of Religion (AAR) fondée en 1909, la plus importante association mondiale de chercheurs sur le sujet et dont le congrès annuel a une portée considérable, est l’héritière du courant occidental dominant. Son cadre de pensée considère que les institutions que l’on appelle religions se rattachent d’une manière ou d’une autre à une forme de transcendance – soit la vision occidentale traditionnelle de la religion.
Face à l’AAR, la North American Association for the Study of Religion (NAASR), créée en 1985, représente un courant critique qui s’exprime en particulier dans sa revue, la Method and Theory in the Study of Religion. Ce courant critique a réellement été lancé par un livre fondateur publié en 1993, Genealogies of Religion, écrit par l’anthropologue Talal Asad. Il sera le premier à remettre en perspective la relativité de la notion de religion, montrant que cette dernière est historique et que ses tentatives de définition ne peuvent que l’être également.
En ce sens, ce double historicisme est aux antipodes de la vision théologique portée par le courant de l’AAR, qui nous imprègne en France à travers notamment des auteurs comme Mircea Eliade (1907-1986). A ce livre fondateur, il faut ajouter deux autres ouvrages majeurs pour ce courant critique : Orientalism and Religion (1999), de Richard King, et Manufacturing Religion (1997), de Russell T. McCutcheon.
Comment expliquez-vous l’ignorance de ce courant critique en France ?
Cela s’explique d’abord par une raison pratique : les auteurs majeurs de ce courant ne publient qu’en anglais. Inversement, si vous n’écrivez qu’en français, vous êtes condamné à la marginalité. J’en ai moi-même fait l’expérience, car c’est une fois mes travaux traduits en anglais qu’ils ont acquis une portée internationale – j’ai pu recenser leur mention dans une trentaine de pays.
En même temps, les ouvrages de ce courant, y compris les plus fondamentaux, n’ont pas été traduits en français. La question de la langue constitue donc un frein majeur à la diffusion de ces idées. Mais celle-ci s’ancre dans un contexte initial défavorable : en dehors d’une section de l’Ecole pratique des hautes études (EPHE, Paris) – mais qui fait essentiellement de la philologie – et, pour des raisons historiques, de l’université de Strasbourg, il n’existe aucun département universitaire de sciences des religions en France. Les recherches théoriques fondamentales dans le domaine de l’histoire des religions y ont pris, de ce fait, un retard considérable. En conséquence, nous n’avons que des spécialistes d’histoire religieuse, c’est-à-dire d’histoire de telle ou telle religion à une époque donnée.
Je suis tenté de penser que cela va de pair avec la grande frilosité sur les questions religieuses en France, qu’on n’aborde qu’avec des pincettes. Je dois d’ailleurs confesser que le sujet m’interroge profondément : dans le pays républicain qui a inventé la laïcité, on se rend compte que presque toutes les personnalités influentes dans le domaine se rattachent elles-mêmes à une foi.
Le « Que sais-je ? » (PUF) sur les religions a été rédigé par un cardinal, Paul Poupard ; Jean Delumeau (1923-2020), qui a occupé la chaire d’histoire des mentalités religieuses au Collège de France de 1975 à 1994, était lui-même catholique ; Michel Meslin (1926-2010), qui a dirigé le département de sciences des religions à la Sorbonne, était lui aussi croyant. Cette sorte de cooptation m’a toujours semblé très étrange dans notre pays laïque : j’aimerais comprendre pourquoi, en France, l’essentiel des postes universitaires ayant pour vocation de s’interroger sur les religions et leurs origines, et souvent les plus importants, sont confiés à des croyants.
Comment la religion a-t-elle été « inventée » et quels sont les problèmes posés par cette genèse ?
L’invention des religions se joue au XIXe siècle. Au début de cette période, il en existait trois pour les savants occidentaux – les trois monothéismes : le christianisme, l’islam et le judaïsme, le reste étant rangé dans une catégorie obscure qualifiée d’idolâtrie. Lorsqu’un siècle plus tard se tient le premier Parlement des religions du monde à Chicago, en marge de l’Exposition universelle de 1893, on en comptabilisait officiellement une dizaine.
Cet essor a en particulier eu lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui a correspondu au formidable développement des grands empires coloniaux. Les penseurs occidentaux, en particulier les Britanniques en Inde, ont alors été confrontés à des faits culturels qu’ils vont reconfigurer et reformater sur le modèle de la religion chrétienne. Vont ainsi être créés comme des « religions » l’hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, le shintoïsme, le zoroastrisme, le confucianisme ou encore le taoïsme, que l’on a privilégiés parce qu’ils possédaient des textes sacrés, à l’instar de leur modèle chrétien.
L’avantage de ce schéma permettait de placer tout naturellement l’homme occidental et « sa » religion au sommet de l’évolution, dans le droit-fil de la pensée évolutionniste du XIXe siècle qui imaginait la progression « religieuse » de l’humanité en trois étapes : elle allait des religions primitives caractérisées par leurs manques – de textes, de morale, de transcendance… – au polythéisme puis au monothéisme. L’ensemble de ce découpage ne repose sur rien d’autre qu’un préjugé favorable au monothéisme biblique. Mais ce schéma mental persiste encore aujourd’hui, alors même qu’il laisse de grands vides sur la carte de l’humanité en éludant les cultures précolombiennes, africaines, sibériennes ou océaniennes.
Vous importez justement les notions d’« impérialisme cognitif » et de « violence épistémique » pour qualifier les conséquences de cette création occidentale des religions…
Ces deux notions – que j’emprunte en effet à Timothy Fitzgerald pour l’« impérialisme cognitif » et Richard King pour la « violence épistémique » – formulent brillamment la dépossession opérée par la pensée occidentale : le propre de cet impérialisme cognitif est d’obliger les autres à se penser dans nos catégories.
A partir du moment où les Indiens ou les Japonais admettent qu’ils ont une religion, ils vont la formuler dans les termes de la culture dominante. Cette forme de domination est beaucoup plus retorse que les autres, car ce n’est pas une violence physique, mais elle est parvenue à complètement défigurer ces cultures pour leur substituer quelque chose qui était familier à nous, les Occidentaux, afin que nous soyons capables de les penser.
Mais, en même temps, cette uniformisation du cadre de pensée conduit les peuples à parler une langue commune, et c’est aussi en se définissant comme hindous, cette catégorie pensée par les Britanniques, que les Indiens ont façonné un nationalisme qui les conduira à l’indépendance.
Si vous pointez un impérialisme masqué dans le concept de religion, vous vous attaquez aussi à la façon dont celle-ci est pensée. Que reprochez-vous à ce que vous nommez la « phénoménologie de la religion » ?
Le courant de la phénoménologie fondé par Edmund Husserl (1859-1938), dont l’influence depuis un siècle a été majeure, oppose le monde des perceptions sensibles à celui des essences. Cette pensée est donc organisée autour de cette notion, qui, depuis Platon, constitue le cadre de la philosophie idéaliste de l’Occident : il y aurait un monde visible et humain qui serait l’antithèse d’un monde inaccessible des idées.
C’est cette notion d’essence qui permet de passer d’Husserl à la phénoménologie de la religion, dont le point commun est l’idée de transcendance – laquelle est incorruptible et éternelle, comme les essences. De ce fait, la religion est traditionnellement pensée comme une sorte de disposition innée chez l’humain. Cette idée, à la fois indémontrable et arbitraire, rejoint la théologie catholique voulant que Dieu ait pourvu les humains d’une âme religieuse, faisant de ce fait de la religion une création divine.
C’est contre cette pensée que le courant critique des religious studies s’élève. Comme l’a souligné Russell T. McCutcheon, cette conception fait de la religion une notion sui generis qui ne s’expliquerait par rien d’autre qu’elle-même, ce qui l’enferme dans un cercle auto-explicatif clos.
Parmi les cibles de ce courant critique, vous mentionnez en particulier le théologien protestant allemand Rudolf Otto (1869-1937) et le philosophe de l’histoire des religions roumain Mircea Eliade. Quels sont les reproches adressés à leur pensée du sacré ?
L’originalité décisive de Rudolf Otto tient au propos avancé dans son principal ouvrage, Le Sacré (1917), qui fait de l’adjectif « sacré » un substantif. Ce dernier devient, sous la plume d’Otto, une transcendance dépassant les différentes traditions religieuses : le sacré apparaît comme une instance singulière qui ne se contente pas d’exister dans telle ou telle culture, mais de façon absolue – en ce sens, la mise en avant de la notion de sacré semble être également une stratégie œcuménique visant à ne pas dire « Dieu », et donc à rendre sa thèse plus acceptable. Otto n’était pas disciple d’Husserl, mais une synthèse s’opère assez aisément dans ce schéma faisant du sacré une essence.
Mircea Eliade reprend, en particulier dans Le Sacré et le Profane (1965), cette notion de sacré telle qu’elle est pensée par Rudolf Otto. Il bâtit ainsi un univers, à la fois platonicien et gnostique, opposant un monde supérieur qui serait celui des hiérophanies – manifestations du sacré – à un monde profane d’ici-bas. Cette pensée binaire sert une opposition ontologique entre ce qui tend vers une plénitude de l’être et ce qui en est dépourvu, condamné de ce fait au statut vulgaire de la matière. Cette vision sert le concept central, chez Eliade, d’homo religiosus qualifiant une prétendue dimension sacrée inscrite au cœur de l’âme humaine.
Comment expliquez-vous l’audience toujours importante de Mircea Eliade, pourtant décrié sur le plan scientifique ?
Mircea Eliade est en effet un cas à part en raison de la forte audience dont il bénéficie encore. J’ai pu m’en apercevoir lorsque j’ai publié Mythologies du XXe siècle. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade (Presses universitaires de Lille, 1993). La partie qui s’est immédiatement avérée être la plus polémique était celle concernant ce dernier, dont je rappelais le passé et la proximité avec des militants du mouvement fasciste de la Garde de fer dans la Roumanie des années 1930 et ses positions foncièrement antisémites, dont j’essayais de montrer en quoi des éléments persistaient dans sa philosophie de l’histoire des religions : ce passage m’a valu des insultes !
Or, sa pensée n’est qu’un bricolage réalisé en piquant des idées à droite et à gauche, sans forcément citer les sources dont il tire sa dette – et en particulier Rudolf Otto sur le concept pourtant clé, chez lui, de sacré. Cette synthèse est d’un éclectisme assez audacieux, qui emprunte aussi bien aux penseurs gnostiques de l’Antiquité qu’à une philosophie païenne de la nature, et dans laquelle on lit également l’influence des théories du psychiatre Carl Gustav Jung (1875-1961) et de penseurs ésotéristes tels que René Guénon (1886-1951), Ananda K. Coomaraswamy (1877-1947) et Julius Evola (1898-1974) – autant d’héritages difficiles à décrypter en raison de l’absence d’étude de la pensée ésotérique contemporaine à l’université.
Sur le fond, Eliade n’est qu’un vulgarisateur dont la pensée repose sur des bases scientifiques extrêmement faibles et qui répète un propos similaire dans chacun de ses livres sans jamais définir ses concepts. Comment expliquer, dans ce contexte, qu’il soit toujours aussi lu ? Je crois qu’il sait mettre le public dans sa poche grâce à sa prose lyrique, répondant à l’attente des lecteurs qui veulent qu’on leur parle de mythologie et de transcendance. Chacun projette donc ses désirs et son imaginaire sur cette pensée qui, si elle s’était imposé un travail scientifique méticuleux, n’aurait certainement pas connu un tel succès.
Quel terme permettrait, selon vous, de dépasser celui de religion en rendant justice à la singularité des croyances qualifiées comme telles ?
Ce que qualifie de façon problématique le terme de religion est une réalité simple, à savoir la façon dont toutes les cultures construisent des représentations du monde et de l’homme. Je considère que la « religion », au sens où nous l’entendons en Occident, n’est qu’une vision, qu’une construction particulière du monde, celle des chrétiens, comme les communistes, les nazis, les épicuriens ou les animistes en ont eu une.
Que nous soyons croyants ou athées, nous ne pouvons pas nous passer de ces constructions, qui impliquent toujours une vision de l’homme. Timothy Fitzgerald a proposé de remplacer le mot « religion » par celui de « culture », mais ce terme me semble trop général et imprécis. J’ai moi-même suggéré l’expression de « formations cosmographiques » pour souligner l’idée qu’il s’agit d’une représentation du monde partagée par une communauté… Mais sans trop d’illusions, car il est évident que la notion de « religion » a depuis bien longtemps colonisé les esprits.
Directeur de recherche émérite au CNRS, Daniel Dubuisson a notamment publié L’Occident et la Religion. Mythe, science et idéologie (1998), Dictionnaire des grands thèmes de l’histoire des religions. De Pythagore à Lévi-Strauss (2004). Son dernier livre : *L’Invention des religions (CNRS Editions, 240 p., 24 €).


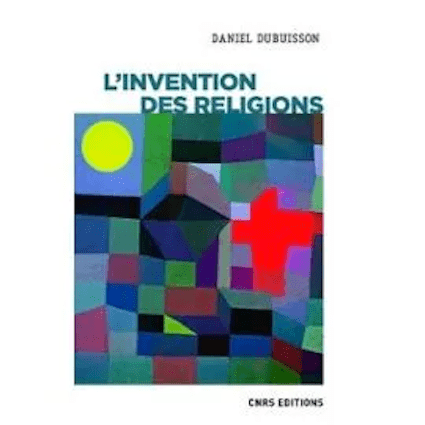
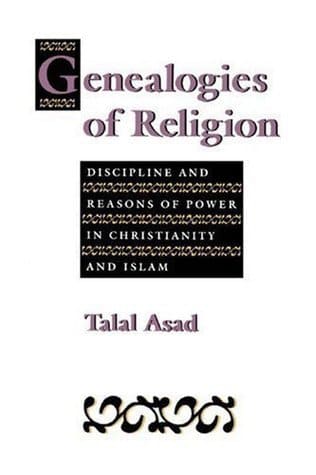
La « religion » au sens du « lien » (religare) a toujours existé. Il s’agit d’un lien horizontal entre individus qui partagent des traditions communes de culte envers une divinité La « religion » au sens du « lien » entre citoyens d’un Etat donné est spécifique à la Rome païenne. A Rome, le lien civique est de nature religieuse. Telle est l’origine du concept appliqué par l’Islam : « din wa dawla »/religion et Etat. Le Christianisme, à l’origine, n’était pas supposé être une religion dans ce sens là. En Palestine, il était une homilétique juive. Dans le monde hellénistique, il a engendré plusieurs écoles de pensée philosophique… Lire la suite »