LE FIGARO. – En juillet 2017, vous êtes lauréat du prix Albert-Londres 2017 du livre pour Les Revenants, enquête majeure sur les djihadistes français qui reviennent de Syrie. Puis vous disparaissez de la circulation… Que s’est-il passé ? Avez-vous été menacé ?
David THOMSON. – J’ai en effet quitté la France à cause des menaces. Je ne sais pas si l’on peut s’habituer aux menaces de mort. Elles ont commencé début 2013, quand j’étais correspondant en Tunisie pour RFI, à cause du début de l’opération « Serval » au Mali. Ensuite, chaque année, ma situation sécuritaire s’est dégradée. À partir de l’été 2016, les menaces de mort se sont intensifiées, de plus en plus personnalisées et circonstanciées. Un jour, j’étais à la terrasse d’un café, je reçois un appel d’un commandant de police : « Bonjour, vous venez d’être placé sous protection policière. Vous êtes où ? O.K., on arrive. » Un an et demi après, je suis toujours placé sous protection policière par le service de la protection de la police nationale, le SDLP. Nous sommes une quinzaine de civils dans ce cas en France. J’ai fait la connaissance d’officiers de sécurité extraordinaires. L’un d’entre eux m’a dit tout au début : « Nous sommes là pour prendre une balle pour vous. » Cet officier de sécurité était un ami de Franck Brinsolaro, le policier tué pendant le massacre de Charlie. Je leur suis très reconnaissant. Durant mon travail en France, j’ai rencontré des djihadistes qui sont chauffeurs de taxi, agents de sécurité et même auxiliaires de police au guichet d’un commissariat. Il m’est arrivé d’en recroiser certains par hasard. La pression en France était devenue trop forte. J’ai donc dû quitter mon pays, pour commencer un nouveau cycle journalistique aux États-Unis.
Vous avez expliqué que le sujet était parfois difficile à porter psychologiquement. Au-delà des menaces, vouliez-vous tourner la page ?
J’ai pratiqué pendant six ans un journalisme d’anxiété sur un sujet radioactif. Un travail au contact direct des djihadistes, qui ne pronostique et n’annonce que de tristes nouvelles, qui sidèrent tellement qu’on ne peut se les représenter avant de les vivre, et où la détresse sociale et la mort sont omniprésentes. On ne peut pas passer sa vie à sonder le pire de l’âme humaine. Quand on est immergé dans le terrorisme, il est difficile de vivre normalement. En 2015, je connaissais une partie des assaillants, je connaissais aussi plusieurs personnes dans le Bataclan et c’est le XIe, quartier que j’habitais, qui a été frappé. On ne travaille pas impunément sur ce sujet, et les conséquences en termes de vie privée sont fortes. Avec ce deuxième livre, Les Revenants, j’avais par ailleurs le sentiment d’avoir épuisé journalistiquement cette thématique. Indépendamment des menaces, j’avais décidé d’arrêter. Il était temps de tourner la page et de changer de sujet. Je ne voulais pas ressembler à la caricature médiatique que j’ai souvent dénoncée: ces experts faussaires abonnés aux plateaux télé pour meubler du vide avec du vide et qui continuent d’occuper, hélas, la majeure partie du temps d’antenne.
Malgré votre départ, les acteurs continuent-ils à vous contacter ?
Avez-vous gardé des liens ? J’ai moins de contacts avec cet univers. J’ai néanmoins conservé des liens qui dépassent maintenant le cadre strictement journalistique, avec un revenant. Sur quarante personnages interviewés pendant six ans pour mes deux livres, ce jeune est un des seuls à me donner le sentiment d’avoir sincèrement rompu avec cette idéologie.
Depuis la faillite de l’État islamique, quel est leur état d’esprit ? Il y a un an, vous écriviez : « Si ces revenants sont parfois déçus de leur expérience en Syrie, ils ne sont pour la plupart nullement repentis. » Est-ce toujours le cas ?
Je n’ai pas mené d’entretien depuis la chute de Mossoul ; je me suis arrêté au début de la bataille. Mais en effet, les centaines d’heures d’interviews menées pendant deux ans et demi pour le livre permettent de dresser cette tendance: les revenants reviennent déçus mais, pour la plupart, fidèles au courant djihadiste de l’islam sunnite. Une des femmes rencontrées en France me disait ainsi être revenue de Syrie après avoir subi enfermement et violences sous l’EI tout en me confiant que l’attentat de Charlie Hebdo avait été « le plus beau jour de sa vie». Il faut noter aussi cette autre tendance tirée des entretiens menés sur la longueur avec sept détenus terroristes incarcérés en France. Dans le huis clos carcéral, les djihadistes ont tendance à s’enraciner dans leur idéologie et dans leurs intentions terroristes, que ce soit dans la prison ou au dehors.
Vous avez commencé à travailler sur le phénomène djihadiste après les printemps arabes en 2011 et vous avez tiré la sonnette d’alarme dès 2014 sur le risque d’attentats en France. Vous vous êtes alors heurté au déni des « élites » médiatiques et politiques… Ces dernières commettent-elles les mêmes erreurs au sujet des revenants aujourd’hui ?
Ceux qui tournaient en dérision mes propos en 2014, quand j’essayais de les alerter sur les intentions terroristes des djihadistes français partis en Syrie, ont encore micro ouvert dans tous les médias audiovisuels. De nombreux experts de la non-expertise monnayent leur label « vu à la télé » auprès de l’autorité publique et certains ont fini par avoir l’oreille du précédent gouvernement. D’où les retards et erreurs d’analyse en France face à la menace terroriste. Ce phénomène est passé en dessous de tous les radars entre 2012 et 2013, et quand les autorités se sont réveillées, mi-2014, il était trop tard. Aujourd’hui, tout le monde a malheureusement compris le danger. Cette fois, le problème est difJe férent. La démocratie ne lutte pas à armes égales avec le djihadisme. Les djihadistes ont la mémoire longue et opèrent patiemment sur le temps long, surtout quand ils sont en prison. C’est moins le cas de la justice française. On estime que plus de 50% des détenus terroristes déjà condamnés sont censés sortir de prison d’ici à 2020. Sur le court terme, l’intensité de la menace terroriste est donc moins forte en France; je crains que cela ne soit pas le cas sur le long terme.
Le nouveau gouvernement a renoncé à la politique de « déradicalisation ». Est-ce finalement le signe d’une meilleure compréhension du phénomène djihadiste ?
Je le pense, et une vraie inflexion a été donnée en matière de prévention avec l’arrivée de personnalités nouvelles comme Muriel Domenach à la tête du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR). Dans mon livre, j’explique, sur la base de témoignages de djihadistes, pourquoi la déradicalisation institutionnelle est une chimère. Une des revenantes raconte qu’une des premières choses qu’on lui a demandées dans ces centres était de témoigner sur BFM pour raconter comment elle avait été bien « déradicalisée ». Quelques mois plus tard, elle repartait en Syrie. Il n’existe aucune méthode de déradicalisation d’État. Beaucoup ont prétendu le contraire pour des raisons politiques ou mercantiles. D’authentiques escrocs ont été abreuvés de centaines de milliers d’euros de subventions publiques dans l’opacité. Trois ans après les premiers programmes, si l’on fait le bilan, parmi les trois principales figures médiatiques de la déradicalisation, une a été condamnée pour détournement de fonds publics, un autre est en prison, mis en examen pour viols présumés de patientes et exercice illégal de la médecine, enfin la dernière est largement décrédibilisée, entre autres raisons parce que plusieurs des jeunes femmes passées par son « centre », dont une présentée sur tous les plateaux télé comme modèle de réussite de sa méthode de déradicalisation, sont parties en Syrie. Il a fallu passer par ces errements, coûteux, pour arriver à une meilleure grille d’analyse et que ces individus trouvent aujourd’hui portes closes dans les ministères.
Le débat sur le sort à réserver aux djihadistes arrêtés en zone irako-syrienne fait rage en France. Trois avocats, Marie Dosé, William Bourdon et Martin Pradel, dénoncent par des plaintes le refus de la France de rapatrier ses ressortissants. Le gouvernement estime que les prisonniers doivent être jugés sur place. Fait-il preuve de cynisme ou de réalisme ?
En rejoignant un groupe terroriste, les djihadistes savaient où ils mettaient les pieds. Dès septembre 2014, de Syrie, ils promettaient, je cite, de « mettre la France à genoux » en tuant des civils. Sur zone, tous les djihadistes ont porté les armes. Les avocats font leur travail. Il est à noter que William Bourdon faisait partie de mes contradicteurs les plus virulents en 2014, quand j’essayais d’expliquer que les djihadistes partis en Syrie avaient des intentions terroristes contre la France. Son erreur d’analyse s’explique sans doute par le fait qu’il a parmi ses clients un authentique exdjihadiste, ancien de Guantanamo, que je connais et qui lutte aujourd’hui contre cette idéologie. Mais ces cas sont très rares dans ce milieu. Par ailleurs, je connais très bien Martin Pradel, puisque c’est mon avocat. Il est très attaché à la défense des libertés fondamentales en France mais aussi en Afrique, au Maghreb et en Turquie. Je comprends sa démarche en tant que juriste, mais, à mes yeux, un détenu terroriste n’est pas un détenu comme un autre. Il est impossible de s’assurer de la sincérité du repentir d’un djihadiste. N’oublions pas les précédents, comme celui du Belge Oussama Atar, parti rejoindre le premier djihad irakien, condamné en 2005 à dix ans de prison en Irak. Se présentant comme repenti et malade, il avait bénéficié en Europe d’une vaste campagne de soutien conduisant à sa libération anticipée. Il a ensuite regagné le djihad en Syrie pour devenir un des coordinateurs des attentats du 13 novembre. Je pourrais citer des dizaines d’autres exemples comme celui-ci.
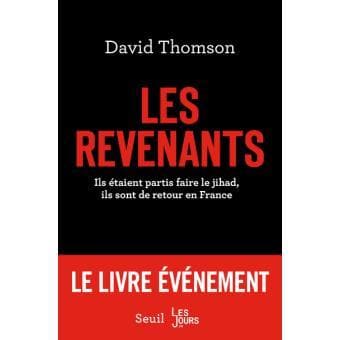
Dans un reportage diffusé sur France 2, Yassin, djihadiste français originaire de Lunel, s’exprime après avoir été arrêté par les forces kurdes en Syrie. Il dément avoir combattu avec l’État islamique et explique s’être engagé pour retrouver son frère. « Je veux juste rentrer chez moi », dit-il. Le connaissiez-vous ? Faut-il le croire sur parole ?
J’ai mené quelques entretiens avec lui et j’ai perdu sa trace fin 2016. Avant de partir en Syrie par suivisme, il avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Il n’avait aucune pratique religieuse. Il a commencé à prier en Syrie. Il a rejoint des Lunellois là-bas au moment où ils posaient fièrement sur Facebook kalachnikov à la main, devant des BMW, comme dans un clip de rap. Sur place, il a intégré la brigade Tariq Ibn Ziyad de l’EI, fondée en juillet 2015 par un ancien légionnaire français vétéran d’Afghanistan, lui aussi de Lunel, Abou Souleyman. Cette brigade d’Européens sous émirat franco-marocain a beaucoup combattu en première ligne, à Deir ez-Zor et à Mossoul, mais je ne sais pas quel poste Yassin occupait. Lors de notre dernier échange, après l’attentat suicide de son frère, Yassin voulait rentrer en France. Il a fait quelques séjours dans les prisons de l’EI, qui le suspectait de désertion. Il essayait de contacter des avocats français pour rentrer.
Émilie König, figure de la mouvance djihadiste française détenue par les forces kurdes en Syrie, demande son rapatriement aux autorités françaises. Les autorités et les observateurs ont-ils fait preuve de naïveté concernant les femmes djihadistes en les considérant comme victimes ?
Cette femme a fait partie des premières Françaises en Syrie. Grâce à Facebook, dont la responsabilité dans ce phénomène est colossale, l’une de ses principales activités était de faire venir d’autres femmes au sein de son groupe terroriste. Elle était mariée à un djihadiste français de Nîmes, tué pendant la bataille de Kobané en 2015 et qui est l’auteur d’une des toutes premières vidéos Facebook de djihadiste français appelant à commettre des attentats sur le sol français. Dans mon livre, j’ai essayé de casser le paradigme prévalant jusqu’à l’attentat raté des bonbonnes de Paris à l’été 2016 qui faisait systématiquement des femmes djihadistes des victimes de leur mari et qui donc les déresponsabilisait totalement. En raison de ce biais de genre qui renvoie à une représentation sexiste de la femme, elles n’étaient quasiment pas envoyées en prison au retour de Syrie. Il n’y a aucune différence à faire entre un homme et une femme en matière de djihadisme, les niveaux de détermination et de dangerosité sont les mêmes.
Reste le cas des enfants, ceux que l’on appelle les « lionceaux de l’État islamique »…
Ces enfants ont vécu en zone de guerre, ont été conditionnés et socialisés dans un groupe terroriste, certains ont été forcés d’exécuter des otages avant même d’avoir 10 ans. Dans mon livre, l’une des revenantes, rentrée de Syrie pour accoucher en France, détaille les crises d’angoisse post-traumatiques de son nourrisson, qui pourtant est né en France. Ces quelque 400 enfants français ont été élevés par des parents fanatisés dans «l’amour du djihad» pour être les terroristes de demain. Leur retour en France est un défi majeur pour les autorités.
En pleine déroute militaire après avoir perdu la ville de Manbij, en Syrie, l’État islamique déclarait : « Nous avons perdu une bataille, mais nous avons gagné une génération qui connaît son ennemi. » Est-ce le cas ?
J’ai choisi cette phrase pour être la dernière de mon livre. Elle reflète malheureusement la réalité. Même si aujourd’hui l’EI n’est plus en mesure de générer cette « transe collective », pour reprendre l’expression d’un revenant, même si la phase d’euphorie est terminée pour les djihadistes, l’organisation a inséré le logiciel terroriste dans le cerveau d’un nombre inédit de jeunes Français. Aujourd’hui, l’EI a perdu ce qui faisait sa force, le contrôle territorial qui lui permettait de dire à ses partisans que l’utopie d’une cité idéale pour tous les musulmans avait été créée. Mais l’EI n’a pas disparu. L’EI a repris sa forme initiale, celle d’avant 2014, c’est-à-dire celle d’un mouvement terroriste clandestin. Et l’EI et ses appels au meurtre restent présents dans l’esprit de ses partisans, dont la plupart sont aujourd’hui dans les prisons françaises. Un revenant me disait d’ailleurs : «J’ai quitté la Syrie pour fuir Daech, et j’ai retrouvé Daech à FleuryMérogis ! »
L’un des revenants, Zoubeir, vous a raconté qu’il a basculé parce que la société contemporaine ne répondait pas à sa quête de sens. « On nous pousse à consommer, consommer, consommer plus, vous avait-il expliqué. Mais au bout d’un moment, consommer, ça ne donne pas une raison de vivre. Certains ont besoin d’un autre projet. » La France a-t-elle besoin d’un projet ?
Ce jeune incarnait ce que l’anthropologue Alain Bertho a appelé « l’islamisation de la révolte radicale». Le djihadisme a comblé chez lui le vide idéologique contemporain. Il correspondait à la fois à son éducation religieuse musulmane conservatrice et à sa vision politique radicale de la société de consommation, à laquelle il ne pouvait avoir accès et dans laquelle il s’ennuyait profondément. Pour beaucoup, le djihadisme a aussi offert une promesse de vengeance et une promesse hédoniste. C’est ce que j’ai appelé le « LOL Jihad », une kalachnikov dans la main, un smartphone dans l’autre, des Air Max aux pieds. Du pouvoir, un statut. Tout ce qui n’était pas permis, pas accessible dans les «quartiers populaires», d’où les djihadistes sont massivement originaires, devenait possible en Syrie. En Syrie, la hiérarchie des normes sociales s’inversait. De «dominés» en France, ils sont devenus dominants en Syrie en se représentant comme les héritiers du Prophète, seuls garants de la pureté de l’islam authentique. C’était la revanche des « humiliés ».

