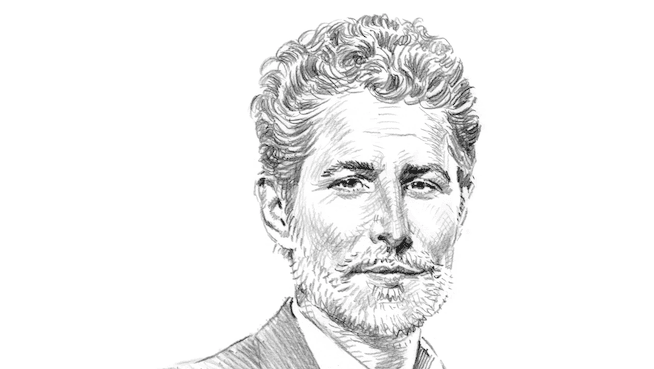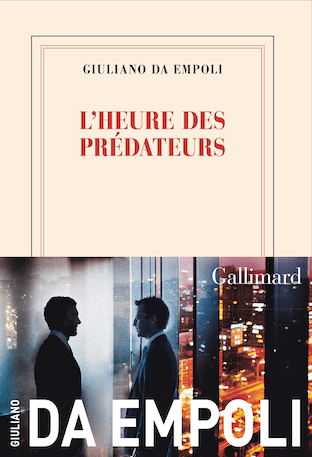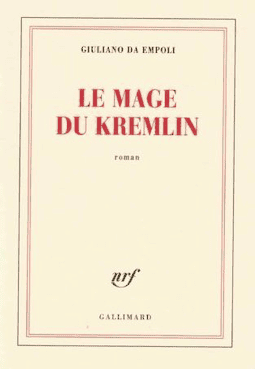Alexandre Devecchio Martin Bernier
Après Le Mage du Kremlin, l’écrivain poursuit son exploration des arcanes du pouvoir, des ÉtatsUnis à l’Arabie saoudite, en passant par les géants de la tech. Il livre ses observations dans L’Heure des prédateurs (Gallimard), un récit crépusculaire et lumineux sur le basculement politique et géostratégique en cours.
LE FIGARO. – Au lendemain de l’élection de Trump, Nayib Bukele, le président du Salvador, écrivait sur X : « Je suis certain que vous ne comprenez pas pleinement la bifurcation de la civilisation humaine qui a commencé hier. » At-on vraiment changé de monde ?
GIULIANO DA EMPOLI. – La réélection de Trump a été une sorte d’apocalypse au sens littéral du terme : non pas la fin du monde mais la révélation de quelque chose. Le chaos, qui était jusqu’alors l’arme des insurgés, est devenu hégémonique. Et nous avons basculé dans le monde des prédateurs. Comme le disait Joseph de Maistre à propos de la Révolution française, « longtemps nous l’avons prise pour un événement. Nous étions dans l’erreur : c’est une époque. »
Derrière le chaos apparent, n’y a-t-il pas une forme de logique dans l’Administration Trump ?
Il y a bien sûr une logique. Mais la science politique des quarante dernières années est tout à fait incapable de l’expliquer. Pour la comprendre, il faut se tourner vers les classiques latins, comme Suétone, Tacite, ou les satires de Juvénal et Pétrone. Même en lisant Machiavel et Guichardin, on voit que les prédateurs comme Trump et Bukele sont des personnages parfaitement typiques. D’une certaine façon, ils représentent la normalité de l’histoire humaine. L’exception était plutôt la phase qui vient de se clore, où l’on a cru que les avocats et les technocrates pourraient toujours gouverner la société.
C’est un « retour à la normale » à l’échelle de l’histoire longue, mais nous vivons un « moment machiavélien », selon vous. Qu’est-ce qui caractérise ce moment ?
En Italie, à la toute fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, le moment machiavélien s’est caractérisé par l’irruption de la force. À ce moment, la technologie offensive s’est développée plus vite que la technologie défensive : des canons à boulets en fonte de fer ont pu percer les murailles des petites républiques italiennes très civilisées de la Renaissance. Il a fallu attendre la moitié du XVIe siècle pour que de nouvelles forteresses capables de supporter les attaques d’artillerie lourde soient construites. Cela a rétabli la paix, mais l’Italie est restée soumise aux puissances européennes jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Aujourd’hui, nous sommes à nouveau dans un moment où les technologies offensives se développent davantage que les technologies défensives. À partir du numérique, lancer une cyberattaque ou une campagne de désin‐ formation ne coûte presque rien, mais la difficulté de la défense est évidente ! Dès lors, nos ‐ petites républiques, nos grandes ou petites démocraties libérales risquent d’être balayées.
Le réarmement annoncé de l’Europe signifie-t-il que les chefs d’État européens ont enfin pris conscience de cette nouvelle donne ?
Nous sommes en train de vivre le choc de l’humiliation. C’est le choc d’une province romaine qui se réveille avec un nouvel empereur ; un pouvoir très différent, imprévisible et arbitraire lui tombe dessus, et elle se rend compte qu’elle n’était qu’une province. Cette humiliation est actée, et elle est là pour durer. Nous n’allons pas en sortir rapidement. Mais elle pourrait être fructueuse dans la mesure où cela peut nous donner l’envie d’en sortir. En sera-t-on ‐ capable ? Il est trop tôt pour le dire.
Vous décrivez un monde régi par les rapports de force : dans les négociations avec la Russie, Trump fait-il preuve de force ou de faiblesse ?
Sur la base des éléments dont on dispose, l’attitude de Trump vis-à-vis de la Russie est tout à fait étonnante. Je partageais ‐ assez l’idée que son retour à la Maison-Blanche représentait une opportunité de changer de dynamique. Mais tout ce qu’on a vu jusqu’ici est déconcertant, même en termes de tactique de négociation : on a vu Trump céder très largement face à Poutine sans obtenir grand-chose.
Parmi les « prédateurs », mettez-vous sur le même plan Poutine, Trump et même Mohammed Ben Salman et Nayib Bukele ?
Les contextes politiques sont évidemment très différents et ils ne produisent pas les mêmes résultats. Mais, au fond, tous obéissent à la même logique. Quand vous êtes dans un moment machiavélien où le chaos domine, il n’y a plus de règles et ce qui prime est le miracle politique. Le miracle, c’est l’intervention directe de Dieu, qui contourne les règles normales de l’existence sur terre pour produire un fait extraordinaire. La logique des prédateurs est la même. Poutine appelle cela le « contrôle manuel » : quand les règles ne marchent plus, lui a le pouvoir d’intervenir directement pour produire le résultat qu’il veut. Cette action directe, surprenante et transgressive produit de la sidération. Depuis César Borgia, c’est cela qui permet aux prédateurs d’asseoir leur pouvoir.
Chez Mohammed Ben Salman et Nayib Bukele, on retrouve l’idée machiavélienne typique selon laquelle la fin justifie les moyens. Ils transgressent donc les règles de façon extrêmement brutale. MBS enferme les 300 puissants du royaume dans leurs suites du Ritz Carlton de Riyad pour les mettre au pas. Borgia a étranglé ses hôtes : c’était pire, mais c’est le même principe ! Ensuite, on peut discuter des fins : en l’espèce, une modernisation de l’Arabie saoudite, une amélioration de la place des femmes, une société qui combat les islamistes et une abolition de la police religieuse en 24 heures. Cette brutalité est au service d’une vision. Il en va de même pour Bukele : il a mis en prison sans procès 80 000 personnes qui étaient tatouées car tous les gangsters sont tatoués au Salvador, mais il estime qu’il a libéré des millions d’habitants qui vivaient dans la peur et sont aujourd’hui dans un des pays les plus sûrs du monde. Toutes les règles sont bafouées, mais parfois les résultats sont au rendez-vous.
Vous dites que les « prédateurs » « se reconnaissent entre eux ». Sur la scène diplomatique, les pays dont les dirigeants ne sont pas des « prédateurs » sont-ils condamnés à être marginalisés ?
Je pense qu’ils ont du mal à se repérer en ce moment. Car les autocrates sont parfaitement habitués à l’idée de se baser sur un petit cercle de fidèles, familial et amical, pour gouverner le pays. Ils trouvent donc tout à fait normal d’établir leur relation avec Trump sur cette base-là. Alors que si vous êtes un gentil démocrate européen, vous allez plutôt vouloir suivre un protocole officiel, vous adresser au ministre des Affaires étrangères et aux ambassadeurs. Cela ne va vous mener strictement nulle part avec Trump. Il est dans une logique plus proche de celle des autocrates et des familles royales – il essaie d’ailleurs lui-même d’établir une sorte de famille royale aux États-Unis. Donc aujourd’hui, il est très difficile pour les tenants du système de s’y retrouver.
Ces gens-là avaient bâti leur compréhension du monde sur le respect des règles et des procédures. Je remarque d’ailleurs que depuis 1980, tous les candidats démocrates à la présidence et à la viceprésidence des États-Unis – à l’exception de Tim Walz – étaient des juristes ! Aujourd’hui, le « parti des avocats » est totalement dépassé. Dans sa pièce Henri VI, Shakespeare fait dire à Dick le Boucher : « Au moment de la Révolution, la première chose à faire est de tuer tous les avocats. » C’est exactement ce que fait Trump aujourd’hui : il va contre les juges et s’en prend aux cabinets d’avocats. Les patrons de la tech suivent la même logique. Ils ne veulent pas de lois ni de règles ; ils veulent juste accélérer.
Les démocrates ne parviennent pas à s’adapter car invoquer le respect des règles face à des problèmes de substance n’est pas une réponse satisfaisante. Face aux images des prisonniers envoyés au Salvador par Trump, ils ont riposté en disant : « Ces gens-là n’ont pas eu de procès. » C’est vrai, et c’est un problème, mais leur réponse est politiquement insuffisante.
Beaucoup continuent à penser que Trump est fou, idiot ou irrationnel. Or vous écrivez qu’« il n’y a pratiquement aucune relation entre la puissance intellectuelle et l’intelligence politique »…
Trump n’est pas intelligent au sens intellectuel du terme. C’est quelqu’un qui ne lit pas du tout. Et je ne parle pas seulement des livres ou des journaux (c’est presque acquis) : il ne lit même pas les dix lignes de notes que ses conseillers rédigent pour le préparer avant un rendez-vous. Il ne fonctionne qu’à l’oral. Et pourtant, il a une pertinence politique et un instinct du pouvoir qui sont remarquables. À l’inverse, il y a des gens très intelligents qui sont des politiques tout à fait minables.
Pendant son premier mandat, Trump pouvait paraître hostile aux géants de la tech, et vice versa. Avec Elon Musk, on se retrouve avec un mélange des genres au gouvernement. Comment l’analysez-vous ? Cela acte-t-il leur prise de pouvoir ?
Trump n’est certainement pas une marionnette. C’est un homme de pouvoir qui a sa propre logique, et il n’est pas soumis à la tech. Mais nous assistons à une convergence entre les oligarques de la tech et des personnalités politiques extrêmes. Au départ, les patrons de la tech apparaissaient comme de gentils jeunes hommes en sweat à capuche, puis ils sont montés en puissance depuis vingt-cinq ou trente ans au point de devenir des puissances comparables à des États. C’est à l’époque d’Obama que tout a basculé : en 2012, le patron de Google, Eric Schmidt, a été plus important pour sa réélection que Musk pour celle de Trump, mais il est resté à sa place, en coulisses. Aujourd’hui, un nouveau palier est franchi : les seigneurs de la tech ont compris que leur intérêt est de balayer les anciennes élites politiques.
Les vieilles élites économiques s’accommodaient parfaitement des gentils sociaux-démocrates et des gentils libéraux, un centre gauche et un centre droit assez semblables et plutôt technocratiques. C’étaient les pistes bleues de Davos, une trajectoire gentiment balisée. Là, nous sommes arrivés dans La Montagne magique. Les géants de la tech ont « une sacrée envie de foutre le bordel », pour reprendre le titre du livre de Xavier Niel. Le slogan de Facebook était d’ailleurs : « Move fast and break things. » On retrouve cette logique de transgression : il faut tout casser, s’affranchir des autorités et des règles pour déployer une nouvelle vision. Cela converge parfaitement avec les vues de prédateurs comme Trump, qui sont eux aussi des outsiders et veulent se libérer des contraintes de l’establishment.
Face à ce bouleversement technologique, le pouvoir politique doit-il accompagner le mouvement, essayer de le réguler, de l’empêcher, ou est-ce déjà trop tard ?
Il est probablement trop tard. Il serait tout à fait imbécile de s’opposer à l’intelligence artificielle – je ne suis pas luddiste -, mais il y a un grave problème de gouvernance de la tech. Les nouvelles technologies et les projets d’intelligence artificielle vont peut-être nous emporter dans le prochain stade de l’évolution humaine. Et il n’est pas normal que tout cela se fasse entre les mains de quelques entreprises privées et personnages tous plus terrifiants les uns que les autres sans le moindre garde-fou.
Les vieilles élites politiques se sont comportées face aux géants du numérique comme les Aztèques face aux conquistadors. Ils auraient pu vaincre les 200 Espagnols qui sont apparus sur les rives, mais ils ont été impressionnés par leurs chevaux et leurs fusils, ces bâtons d’où sortent le feu et le tonnerre. Ils n’avaient jamais vu cela et ont pris ces hommes pour des dieux. Le rapport des politiques aux jeunes gens à capuches a été exactement le même. Ils ont pensé que c’étaient des extraterrestres – ils l’étaient d’une certaine façon. En restant dans cet état de fascination, la vieille élite n’a pas été capable de réagir. Et elle a mérité d’être balayée.
Cela nous mène-t-il nécessairement au chaos, ou Trump a-t-il raison quand il parle dans son discours d’investiture de « nouvel âge d’or » ?
S’il arrive, l’âge d’or n’est pas pour demain. Je pense que le chaos va encore s’accentuer. Cela étant, il est possible que cette phase de transition chaotique porte un nouvel ordre de quelque type. C’est d’ailleurs la vision des gens de la tech ; ils n’imaginent pas le chaos permanent mais le voient comme un instrument pour faire advenir un nouvel ordre. Un ordre qui ne serait plus démocratique mais, selon eux, bénéfique pour tout le monde car les choix seraient faits de façon rationnelle par des algorithmes.
Les peuples qui supportent déjà de moins en moins les élites technocratiques pourraient-ils supporter un gouvernement technologique ?
Peut-être pas. Le véritable roman d’anticipation sur l’IA a été écrit par Kafka. Comme dans Le Procès et Le Château, l’IA prend des décisions sans que personne ne sache sur la base de quels critères. C’est déjà une réalité pour une partie des gens qui travaillent. Les livreurs n’ont presque plus de lien avec un supérieur humain : ils sont seuls face à l’application et son algorithme. Et cette forme d’organisation va se répandre dans les couches supérieures de la société ; les avocats et les médecins y seront soumis.
Sera-t-on prêt à tolérer un système de plus en plus technocratique ? C’est la vraie question. L’intelligence voudrait qu’on essaie d’intégrer ces instruments de façon démocratique, ce qui n’est pas impossible. Rilke disait : « Je vis en mauvaise intelligence avec les appareils photos parce que je trouve qu’ils sont trop arrogants et ils n’ont pas l’humilité que les machines devraient toujours avoir. » J’aime cette idée de l’humilité des machines. Or, pour rendre les machines humbles, il ne faut pas être luddite ; il faut au contraire être suffisamment avancé technologiquement pour pouvoir dompter la machine.