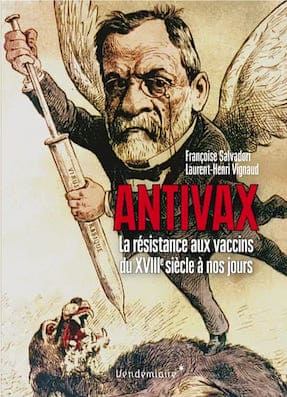Propos Recueillis Par Chloé Hecketsweiler
Spécialiste de l’histoire des sciences, Laurent-Henri Vignaud met en perspective la crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui avec celles qui ont agité le monde à travers les siècles
Laurent-Henri Vignaud est maître de conférences d’histoire moderne à l’université de Bourgogne, spécialiste de l’histoire des sciences. Il explique comment s’est forgé le concept de contagion, et de quelle façon les épidémies, comme les mesures prises pour les contrôler, ont façonné nos sociétés.
Quand la notion de contagion est-elle apparue ?
Dans la pensée archaïque grecque, il y avait l’idée que les maladies étaient causées par un poison que l’on appelait « contage » et d’où dérive le mot « contagion ». Mais, au Ve siècle avant J.-C., cette conception a été remplacée par celle d’Hippocrate, selon qui la maladie résulte d’un déséquilibre entre les « humeurs ». On en retrouve la trace dans le mot « choléra », qui vient du grec cholê, la bile. Cette théorie a prévalu jusqu’aux travaux de Pasteur et de l’Allemand Koch, mettant en évidence le rôle des virus et des bactéries dans la propagation des maladies infectieuses.
Malgré cela, lors des épidémies de choléra qui frappent l’Europe au XIXe siècle, il y a tout un débat entre les « contagionnistes », convaincus du rôle des microbes, et les « anti-contagionnistes », persuadés que la santé n’est qu’une question d’hygiène générale : bien manger, respirer de l’air frais, se laver les mains.
Il a fallu du temps pour que l’origine microbienne des maladies infectieuses s’impose…
Il y a une étude célèbre, celle du docteur Snow, qui a étudié le choléra dans les années 1850, à Londres. Il a démontré que la contamination était liée à l’eau d’une fontaine de Broad Street qui était contaminée et a essayé de la faire sceller. Ses conclusions ont cependant laissé la plupart de ses contemporains incrédules, à commencer par les habitants du lieu, pour qui l’eau de cette source était particulièrement pure.
La même consternation a frappé les habitants de Hambourg, en 1892, lors d’une autre épidémie de choléra. La ville était réputée pour son hygiène exemplaire : les habitants bénéficiaient du tout-à-l’égout, les rues étaient propres, les logements salubres. Il était impensable qu’une telle maladie dite « des mains sales » s’y répande. Personne ne voulait croire que les seules allées et venues dans le port pouvaient être à l’origine du retour de l’épidémie.
Quels sont les premiers exemples de quarantaine dans l’histoire ?
A l’époque médiévale, la ville de Raguse, à la fin du XIVe siècle, puis la République de Venise, au début du XVe siècle, plaçaient en quarantaine les navires en cas de suspicion de maladie à bord. Venise avait aussi décidé de fermer les auberges et d’interdire les cérémonies de funérailles pendant l’épidémie de peste. La première fois que l’on a vraiment tenté de minimiser la propagation d’une épidémie en France, c’est en 1720 à Marseille. Pour protéger la Provence de la peste, un cordon sanitaire très strict avait été mis en place autour de la ville, avec l’interdiction d’entrer ou de sortir. La maladie a ravagé Marseille – la population a été divisée par deux –, mais les provinces alentour n’ont pas été complètement épargnées. Comme vous ne pouvez pas avoir un soldat tous les mètres, des habitants sont sortis, et l’épidémie s’est répandue malgré tout en Provence et dans le Gévaudan, où 50 000 personnes sont mortes, en plus des 40 000 Marseillais.
Ces mesures de contrôle de l’épidémie finissent-elles par s’imposer au XIXe siècle ?
A cette époque-là, il y a de vifs débats entre les médecins partisans de mesures drastiques, comme celles prises pendant les épidémies de peste, et les politiques qui craignent leurs répercussions économiques et politiques. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, on hésite. Les républicains de la IIIe République ou bien les libéraux en Angleterre sont assez hostiles à la quarantaine ou à la fermeture des frontières, qui perturbent le commerce.
Les « contagionnistes » ont l’air d’avoir raison, mais leur opinion est dérangeante, car les mesures qu’ils préconisent sont lourdes. Les politiques et, bien souvent aussi les populations, préfèrent finalement l’hypothèse « hygiéniste » selon laquelle vivre dans un environnement sain suffit à se prémunir contre la maladie. Des pays comme la Prusse, à la tradition plus autoritaire, s’accommodent mieux des mesures strictes comme la fermeture des frontières ou la quarantaine des marchandises, mais nulle part ces mesures ne sont appliquées totalement. Les usines sidérurgiques du nord et de l’est de la France, très gourmandes en main-d’œuvre, fonctionnent en partie grâce aux travailleurs transfrontaliers.
Personne n’imaginait qu’il faudrait en revenir à la quarantaine et à l’isolement au XXIe siècle…
Ces mesures prises par les Chinois, puis par une grande majorité des pays frappés par le Covid-19 nous renvoient à l’époque où nous n’avions ni vaccins ni antibiotiques pour combattre les maladies infectieuses. Nous pensions avoir vaincu toutes ces maladies, mais aujourd’hui, face aux coronavirus, nous n’avons aucun médicament. Nous revenons donc à des méthodes anciennes avec l’objectif de ralentir la diffusion de l’épidémie. La maîtrise d’une épidémie, c’est aussi de la politique.
Dans un régime démocratique, le confinement a cependant une efficacité plus limitée que dans un régime autoritaire. On ne peut totalement empêcher les gens de prendre la voiture, le train ou l’avion. Pendant un temps, les Italiens ont essayé de maintenir le foyer de contamination dans le nord du pays. Mais quand les restrictions de circulation ont été annoncées, une partie de la population s’est ruée dans les gares pour partir vers le sud, ce qui a abouti à y disséminer le virus. Le phénomène s’est reproduit en France dès le premier week-end du confinement : selon les chiffres fournis par les opérateurs téléphoniques, entre 15 % à 20 % des Parisiens ont fui la capitale.
Qu’ont révélé les pandémies de grippe au XXe siècle ?
Les pandémies grippales des années 1950 et 1960 marquent un tournant dans l’histoire de la lutte contre les maladies contagieuses. Elles viennent en effet mettre fin brutalement à l’utopie pastorienne : à chaque maladie son vaccin. Alors que les nouveaux vaccins nourrissent l’espoir de voir disparaître certains maux historiques, ces virus grippaux qui mutent rapidement se révèlent très coriaces à combattre. Dès lors, l’OMS ne craint plus qu’une chose : l’arrivée d’un virus x (probablement grippal) qui se répandrait comme une traînée de poudre et ferait autant de morts (de 50 à 100 millions) que la grippe espagnole de 1918.
De quelles façons les grandes épidémies ont-elles façonné la société ?
La grande épidémie de peste, qui a démarré dans les années 1340, a bouleversé la société et les croyances. Près d’un Européen sur deux a été tué, et une partie de la population a vu dans ce cataclysme l’annonce de la fin du monde. Cela a eu un fort impact sur la spiritualité, avec la popularisation de certaines croyances, comme le purgatoire. Au XIXe siècle, les grandes épidémies de choléra ont incité les politiques à prendre des mesures d’hygiène. Il y a eu de grandes réflexions sur l’habitat – notamment ouvrier – la création du tout-à-l’égout, l’accès à l’eau potable. L’hygiène dans les hôpitaux s’est aussi améliorée : on a commencé à utiliser des antiseptiques pour laver les instruments chirurgicaux, on a arrêté de mettre plusieurs malades dans le même lit.
La grippe espagnole a été complètement occultée par la première guerre mondiale. Quand un soldat était malade, on le renvoyait chez lui, et il contaminait tout le village. Ce n’est que bien plus tard que le décompte des décès a été fait : environ 250 000 morts, c’est bien plus que la grippe saisonnière, mais bien moins que le million de morts civils et militaires pour la seule année de guerre 1918. Néanmoins, il s’ensuit une certaine prise de conscience : la France se dote en 1920 d’un ministère de la santé, qu’on appelait alors ministère de l’hygiène. C’est aussi à cette époque que la Société des nations commence à réfléchir à des coopérations internationales pour gérer les épidémies.
Une épidémie est une menace sanitaire, mais pas seulement…
C’est un danger social majeur, car l’épidémie détruit le lien social. Le malade, pour lequel on a d’habitude de la compassion, devient un potentiel ennemi. Les récits de peste nous décrivent des mères abandonnant leur enfant, des maris abandonnant leur femme, des frères et des sœurs se lâchant la main, car la peur de mourir prend le pas sur le sentiment affectif. Une maladie contagieuse a des conséquences sur le plan politique et économique, mais aussi social et mental. Les petits mots accrochés aux portes des soignants par des voisins terrorisés qui leur demandent plus ou moins gentiment d’aller habiter ailleurs sont un indice. Si tous ne sont peut-être pas authentiques, ce comportement est crédible et nous aurions eu de la peine à le croire possible il y a seulement quelques semaines. L’historien Jean Delumeau parlait à propos des épidémies de l’époque moderne et médiévale d’une « dissolution de l’homme moyen », ne laissant plus apparaître que des héros ou des lâches. Aujourd’hui, nous sommes heureusement face à une maladie qui ne tue pas beaucoup. Cet effet de délitement est donc moins évident. Si nous devions faire face à une épidémie comme la peste, l’ambiance ne serait sans doute pas la même.