Première Tunisienne agrégée de lettres modernes, l’écrivaine Hélé Béji anime depuis des années la scène intellectuelle tunisienne. Dans son livre « Islam Pride », écrit avant la révolution tunisienne de 2011, elle évoquait déjà le retour du voile dans les pays musulmans. Cett » féministe et libérale de la « génération Bourguiba » entend penser l’articulation entre tradition et modernité, qui seule peut nous sauver des démons de l’obscurantisme.
PROPOS RECUEILLIS PAR EUGÉNIE BASTIÉ
LE FIGARO. – Des Algériennes se sont mobilisées récemment pour pouvoir porter le bikini à la plage. La liberté vestimentaire est-elle en régression dans les pays du Maghreb ?
Hélé BÉJI. – J’ai toujours porté le bikini. En Tunisie, dans les années 1960, nous portions toutes des mini bikinis vichy à la Brigitte Bardot, nos poitrines serrées dans des balconnets froncés. Nous allions dans la rue en short. Jusqu’à l’émergence de l’islam politique actif, on ne se posait pas la question de la nudité. Si on nous avait dit qu’un jour ce serait un combat d’aller se baigner en bikini, on se serait esclaffées. Aujourd’hui, sur les plages, les bikinis n’ont pas disparu, mais nous devons supporter la présence de ce nouveau monstre marin nommé «burkini». Quel désastre! Pourtant, le mouvement d’émancipation féminine était allé très loin avec les lois d’avant-garde de l’indépendance.
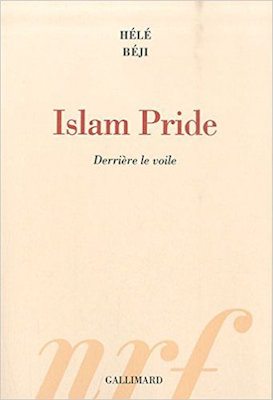
Comment expliquez-vous ce retour du religieux ?
Peut-être parce que les promesses de bonheur de l’indépendance n’ont pas été tenues et ont fini dans la désillusion? Le poids social de la religion s’est alourdi dans les années 1980. Mais au niveau politique, l’État poursuivait son modernisme autoritaire. Ce volontarisme était sans concession. Il favorisait les libertés privées féminines, tandis qu’il brimait les libertés publiques. Ce despotisme séculier, laïciste, occidentaliste, avait permis aux femmes de s’affranchir dans tous les dophénomène maines. On pouvait se baigner en bikini, ne pas jeûner pendant le ramadan, n’exercer aucun culte, exprimer son incroyance, oublier sa foi. Mais il était défendu de critiquer le pouvoir. À un moment, ces libertés privées ont buté sur un obstacle: l’absence de libertés publiques. Peu à peu les droits des femmes se sont élargis aux revendications des droits de l’homme. C’est là que survient la révolution de 2011.
Révolution qui a fini par voir triompher les islamistes…
Oui, l’extension de la démocratie, dans des pays où le peuple est encore pieux et conservateur, a ouvert la représentation politique à l’idéologie religieuse. On s’y attendait. La révolution a diversifié la demande politique à toute la «société civile». Mais la société civile n’est pas une panacée. Il n’y a pas de «société civile» naturellement bonne, vertueuse, éclairée. Elle est également dangereuse, sectaire, obscurantiste. La société est tout aussi incivile que civile. En quelques semaines, on a vu une Révolution non religieuse être récupérée par les courants salafistes. Le voile a fait une percée fulgurante dans la rue, l’administration, les bancs de l’Assemblée, les universités, les écoles, les plages. Un zèle théocratique a envahi les quartiers, condamnant de jeunes athées à la prison. Amina, la Femen tunisienne, a été arrêtée pour avoir dénudé sa poitrine sur Facebook. Son geste a eu le mérite de montrer que l’oppression ne se terminait pas avec la révolution.
Comment avez-vous ressenti ce retour du voile ?
Dans mon livre Islam Pride, écrit avant la révolution, j’expliquais ma sidération devant le retour d’une servitude que je croyais abolie. J’étais ébranlée. Mon rejet était violent. Trop pour que je ne m’interroge pas. J’ai voulu faire un travail sur ma peur. Je me suis rappelé l’humanisme de Montaigne : «Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage.» J’ai évité d’appeler «barbare» le voile, mais au fond de moi, mon émotion est la même, colère et pitié mêlées. Le voile détruit l’universel féminin. Désormais le monde féminin se sépare entre les voilées et les autres. Cette inimitié tranche avec la solidarité historique des femmes. En écrivant, j’ai voulu surmonter cette barrière, cette béance qui ouvre la « guerre civile » entre les femmes. Mais je ne me soumets pas non plus à sa fatalité. Je dis qu’un jour elles se dévoileront, mais pas par la force. Le discours de la laïcité n’est plus efficace face au voile, car ce sont les libertés de conscience instaurées par la laïcité qui le permettent.
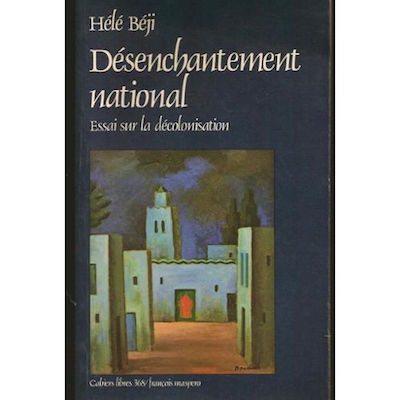
« Elles sont les suffragettes du voile », écrivez-vous. Pour vous, loin d’être un archaïsme, le voile serait donc un produit de la modernité ?
Oui, le voile n’est pas un acte de pure soumission, mais d’affirmation de soi, ultra-individualiste, le «droit des individus à être eux-mêmes», quelle que soit l’absurdité de leur conduite. S’il n’était qu’un symptôme de domination ancien, il serait plus facile à combattre. Mais c’est un symbole revendiqué et non subi, à la fois rebelle et mimétique, comme un phénomène de mode, excentrique et grégaire, une façon intime et spectaculaire de s’approprier son époque. C’est le costume puritain d’un autre féminisme, qui exhibe ses prédilections intimes, sexuelles ou mystiques. C’est un « comingout » religieux, un « islam pride ». En m’intéressant à ces filles derrière leur voile, j’y décèle aussi une grande peur du monde extérieur, de la pression au travail, de la rudesse de la concurrence, de la solitude morale, de la disparition de la famille. On ne peut isoler le voile de l’échec des idéologies progressistes. Il est l’expression la plus visible d’une faillite du monde musulman dans l’accomplissement politique et moral de soi. C’est un qui dit quelque chose sur l’impuissance des États modernes face aux nouveaux maux engendrés par la modernité, aux nouveaux désespoirs liés à la misère sexuelle, la fin du foyer protecteur, le célibat forcé, l’échec amoureux, les familles monoparentales, les enfants à moitié orphelins, la destruction des liens humains, la toxicomanie, le culte de la performance, le stress de l’entreprise, etc. Les démocraties voient renaître une quête de restauration, la sanctification de la famille comme valeur refuge. Voilà ce que dit ce désir «d’islam» dans les sociétés avancées. La religion focalise en elle tous ces manques.
Vous écrivez aussi que « le voile est une cendre noire jetée sur la lumière de la tradition », y a-t-il une vertu de la tradition ?
La tradition n’est pas seulement obscurantisme. Elle est à distinguer de la religion. C’est aussi une narration pleine de civilité, de douceur, de délicatesse, de souci de l’autre, auxquels le temps moderne ne fait plus place. Malgré sa grande pacification des guerres intestines sanglantes, la démocratie a échoué à créer un humanisme entre l’ancien et le nouveau, elle a détruit les antiques usages de civilité, sédimentés par des siècles de transmission. La gratuité, l’élan humain, la spontanéité, le sentiment, la grâce de la relation sont remplacés par un juridisme impersonnel qui réglemente toutes nos conduites, dans une société de moins en moins chaleureuse. Le «communautarisme» n’est pas communautaire, c’est une réaction à l’excès individualiste, un rejet de la solitude absolue. L’islam, notamment pour ces jeunes filles, est peutêtre un moyen de recréer du lien. La soumission qu’il offre est une lassitude de la liberté. L’obscurantisme est fixation sur l’origine, mais la tradition est une esthétique délestée de l’uniformité religieuse. L’obscurantisme fait croire à un âge d’or qui n’a jamais existé, une utopie de pureté, qu’on veut restaurer par des moyens cyniques et inhumains. On transforme la tradition en monstre. En fait, l’idéologie religieuse qu’on l’appelle salafisme ou islamisme déshumanise plus rapidement la tradition que toutes les transgressions du monde moderne.
Comment jugez-vous la législation de la France sur le voile ?
Le problème est le suivant : je perdrais ma dignité si on me forçait à mettre un mouchoir sur la tête, et la fille voilée croirait perdre la sienne si on la forçait à l’enlever. Aucune ne peut obliger l’autre à faire ce qu’elle réprouve. La dignité est le sentiment le plus secret, le plus profond du coeur humain. Donc je préfère raisonner en termes d’efficacité plutôt que de principes. Une législation qui interdirait complètement le voile peut être justifiée au regard de la lutte historique d’émancipation des femmes, mais elle n’est pas efficace : elle manque son but, voire même est contre-productive. Bien sûr, je préférerais ne pas voir de filles en burqa ou burkini, cela me révolte, me heurte, me bouleverse, mais je ne crois pas que l’interdiction soit la bonne solution. Si on interdit le burkini sur les plages, on risque de démultiplier le voile dans les banlieues, en signe de réaction. En revanche, je suis absolument pour la loi qui interdit le voile à l’école, car ce sont des mineures, qu’il faut soustraire au diktat de l’embrigadement des familles ou du quartier. Voiler une petite fille est une pratique attentatoire à l’enfance. L’État doit la protéger par tous les moyens, c’est indiscutable.
Beaucoup d’associations dénoncent dans l’opposition au voile une forme d’islamophobie. Que pensez-vous de cette notion ?
Il faut pouvoir critiquer l’islam sans subir cet anathème. L’islamophobie s’est développée à la suite de meurtres de masse commis au nom de l’islam. On a le droit d’avoir peur de conduites criminelles se revendiquant d’une religion, de s’épouvanter de son message. C’est une angoisse salvatrice. Mais il faut savoir aussi que la société musulmane a un visage de douceur que ne connaît plus le monde moderne. En Tunisie, les habitudes de vie, les cérémonies sociales sont empreintes du vieil esprit de la cité médiévale, d’un islam profane fait de gestes, de politesse, d’urbanité, de respect des vieux et d’amour des enfants, de liens, du goût des autres, indépendamment du dogme religieux. Toute la question est de savoir si cette tradition sera plus forte, plus résistante, supérieure à l’empire idéologique de sa destruction.
« Jusqu’à l’émergence de l’islam politique actif, on ne se posait pas la question de la nudité.
Si on nous avait dit qu’un jour ce serait un combat d’aller se baigner en bikini, » on se serait esclaffées
Y a-t-il selon vous un problème au fond de l’islam qui sécrète la maladie de l’islamisme ?
Les plus érudits des islamologues se sont cassé les dents sur cette question. On ne peut essentialiser une religion puisque toutes ont eu leur part d’atrocités dans l’histoire. On peut simplement tenter d’analyser le décalage temporel entre la psyché des peuples musulmans et celle des peuples occidentaux sortis de la religion. Le rapport des temps, anciens et nouveaux, n’a pas trouvé sa correspondance. Une partie de la population vit encore dans une société où la mort de Dieu est un non-sens, où la croyance se nourrit de l’imaginaire enfantin du paradis et de l’enfer. Le travail philosophique du doute ne s’y est pas accompli. En voulant accélérer ce processus, on provoque une grande violence. Il y a un anachronisme de la conscience islamique par rapport à la conscience moderne. Est-ce que cela vient de l’incapacité de l’islam à s’adapter à la modernité, ou de la modernité à ne plus savoir accueillir avec culture et intelligence les figures de l’ancien? Ou des deux ?
Comment jugez-vous la situation politique en Tunisie ?
La Tunisie a fait une percée majeure dans la constitution d’un État qui ne sera plus jamais la proie de l’islamisme radical. Le processus est irréversible, c’est comme la Révolution française. Avec cette différence que le choix du compromis, c’està-dire celui de n’avoir pas éradiqué par la force le succès politique des islamistes, de ne pas avoir adopté un discours violemment antireligieux comme l’a fait le premier nationalisme d’État, a été judicieux. La sagesse a prévalu sur l’idéologie dans les deux camps. En Tunisie, les islamistes ont eu le pouvoir pendant trois ans, par les urnes, et leur échec gouvernemental les a disqualifiés. Le peuple a découvert que la religion ne suffisait pas à résoudre les problèmes quotidiens des gens. Les islamistes ont compris que les Tunisiens aimaient trop la vie, le monde, l’esprit du temps, que leur histoire les avait nourris d’une forme d’épicurisme et de liberté qui ne se soumettrait jamais à l’oppression de la bêtise fanatique. Cet esprit d’avant-garde vient de s’illustrer par l’annonce du président Béji Caïd Essebsi d’une réforme du droit successoral, afin d’abolir l’inégalité entre garçons et filles en matière d’héritage. C’est un nouveau 13 août révolutionnaire, comme en 1956 !

