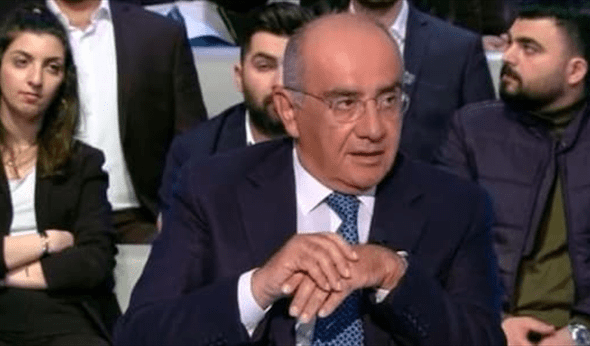|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Nous sommes témoins d’une métamorphose du concept de la justice dans le cadre d’une évolution compatible avec le progrès des sociétés.
Nous sommes face à quatre théories concurrentes de la justice distributive :
1- Le système féodal ou de castes qui se base sur le concept d’une hiérarchie fixe fondée sur la naissance. Naître dans une famille noble suppose le privilège de droits et de pouvoirs auxquels ne peuvent prétendre ceux qui sont issus de familles démunies. Ce modèle est au Liban en voie de disparition, à quelques exceptions près.
2- La conception libertarienne fondée sur le libre marché et associée à une égalité formelle des chances. Celle-ci offre les mêmes libertés, dans un contexte où le libre marché détermine la répartition des biens et des richesses. En pratique, les opportunités sont loin d’être réparties de manière égale. Ceux qui bénéficient de familles susceptibles de les soutenir et qui disposent d’une bonne éducation sont ainsi avantagés par rapport à ceux pour lesquels ce n’est pas le cas. Il est bon de permettre à chacun de prendre part à la course concurrentielle, à condition que la ligne de départ soit la même pour tous. Sinon, la course n’est pas équitable.
Ainsi, les communautés qui avaient le « privilège » de l’éducation et de l’ouverture sur l’Occident ont été « dépassées » par d’autres communautés suite à des changements de conjonctures politiques internes et régionales. Qui plus est, la situation de ces communautés n’est pas restée fixe. Elle a continué à subir des mutations. La communauté chrétienne, à titre d’exemple, se voyait comme privilégiée sous le mandat français. Elle a été « rattrapée » par une montée en puissance sunnite après la guerre, laquelle s’est retrouvée dépassée par une suprématie chiite sous et après l’occupation syrienne. Il s’agit d’un modèle de justice ou bien de pouvoir conforme au dicton : « L’on ne baigne jamais dans le même fleuve ». La route de l’histoire n’a de cesse de tourner.
Cette « alternance » a toujours laissé derrière elle un sentiment de nostalgie de la splendeur perdue et d’amertume chez la communauté qui se sentait laissée pour compte – et créé une voracité, un sentiment de suprématie, et même parfois de vengeance chez les nouveaux maîtres du jeu.
3- La conception « méritocratique » fondée sur le libre marché, associée à une égalité des chances. Il est bon de corriger l’inégalité des chances à travers l’éducation, mais remédier à l’inégale répartition des dispositions naturelles est un principe différent. Si d’aucuns estiment que la « rapidité » naturelle de certains est embarrassante pour les autres, faut-il pour autant imposer dès le départ des semelles en plomb à ceux qui prennent part à la course ? Par exemple, une grande partie de l’opposition à Rafic Hariri trouvait ses racines dans un sentiment d’amertume et de colère au niveau de la rue ou des élites chrétiennes, pour qui il avait spolié un « domaine réservé », considéré comme dévolu aux chrétiens, à savoir le lien avec l’Occident, à travers son influence au Vatican, à l’Élysée, ou à la Maison Blanche – mais aussi par le simple fait de passer ses vacances de ski dans une région considérée comme une « chasse gardée ».
4- La conception égalitariste basée sur le principe de la différence. Cette conception consiste à encourager les personnes de talent à développer leurs dons et à les mettre en pratique, tout en s’assurant que les bénéfices de ce talent sur le marché constituent un plus pour le groupe et la société. Il serait ainsi grave de mettre un handicap quelconque aux coureurs les plus rapides. Il faut au contraire leur permettre d’aller au bout de leurs capacités. Il conviendrait aussi d’admettre que les gains ne leur appartiennent pas exclusivement et devraient être partagés avec ceux qui ne sont pas munis des mêmes dispositions et capacités. Nous avons, contrairement à ce concept, été encouragés à placer nos épargnes dans les banques plutôt que de les investir – donc gagner et faire gagner, pour des raisons complexes.
Au Liban, le contrat socio-politique basé sur la justice et la liberté prend en considération deux autres concepts : les droits des individus et les garanties aux communautés. Les réformes constitutionnelles de 1989 ont abouti à la création d’un système de représentativité bicaméral.
D’une part, un Parlement libéré du frein communautaire, censé assurer les droits des citoyens – il est ainsi impensable d’élaborer et de mettre en pratique une loi sur la circulation pour les chrétiens et une autre pour les musulmans.
D’autre part, un Sénat dont les élus seraient choisis sur base communautaire et qui aurait pour fonction de garantir les spécificités des communautés. Ainsi, si les écoles chrétiennes souhaitent enseigner le catéchisme dans leurs établissements ou bien les écoles musulmanes le Coran, la loi leur garantirait leurs droits. Théoriquement, le Sénat pourrait saisir toute loi votée par le Parlement « laïque » qui toucherait aux spécificités culturelles des communautés.
Évidemment, cette réforme n’a jamais vu le jour pour des raisons de politique politicienne… Cependant, son existence dans la Loi fondamentale nous donne l’espoir de pouvoir la mettre en application un jour.
La nature a horreur du vide. L’État-failli et son corollaire, l’étiolement de la justice, ont laissé le champ libre à une forme de justice communautaire dont les racines sont si profondes qu’elle aspire à modifier, pour ne pas dire contaminer, l’essence même de l’État et de la formule libanaise, aux dépens de la justice individuelle et de la liberté. Michel Chiha disait que ce que l’État perd au Liban, les communautés le gagnent. La pratique lui a donné raison.
La liberté et la justice ne peuvent exister l’une sans l’autre. Sans justice, la liberté serait à la merci des plus puissants. De même, une justice sans liberté ouvre la voie à l’oppression. Contrairement aux idées reçues, une communautarisation excessive, univoque, de la justice – et de l’État – au Liban ne renforcerait pas les libertés. Au contraire. Une justice hypercommunatarisée, dont l’arbitre serait un espace communautaire homogénéisé, conduirait à un affaiblissement du pluralisme, des libertés individuelles et collectives et de la justice pour tous au profit d’une tentation totalitaire. Le Liban en a fait la triste expérience durant la guerre, et le modèle d’un parti théocratique et de son ennemi mimétique, un État théocratique, ne sont pas sans susciter des fantasmes, tout aussi mimétiques, au sein des différentes communautés.
Plusieurs personnalités, académiques, politiques, juristes, journalistes, et militants de la société civile se réunissent partout dans le monde pour débattre de la question de la solidarité, de la modération interarabe et arabo-européenne face à l’extrémisme et à la violence qui menacent des peuples entiers dans leur stabilité.
Notre confrontation repose sur la culture qui est la condition sine qua non de notre vivre ensemble, égaux et différents.
La culture du lien, de la modération, du pardon, de la paix, de la démocratie, des droits de l’homme face à la culture de l’exclusion, de l’extrémisme, de la haine, de la violence, et du retour au tribalisme, fut-il traditionnel ou moderne.
Alors, plus que jamais, gare à la tentation totalitaire, dont le seul remède reste un vivre-ensemble régi par un État de droit et des institutions garantes de la justice et de la liberté pour tous.