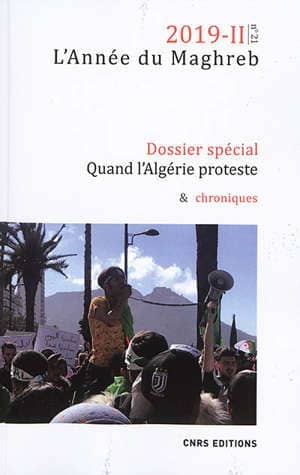Frédéric Bobin
Un peu plus de dix mois d’existence, c’est encore bien frais pour oser de grandes leçons. C’est tout de même assez pour soumettre le Hirak algérien aux lectures que peuvent offrir les sciences sociales. Dans sa dernière livraison annuelle, L’Année du Maghreb mobilise une quinzaine de chercheurs, sous la direction de Thierry Desrues et Eric Gobe, pour tenter de prendre la mesure de ce mouvement de protestation exceptionnel qui enfièvre l’Algérie depuis le 22 février 2019. Le résultat est plutôt heureux pour un projet collectif dont la difficulté, outre le manque de recul temporel, puise dans la jachère scientifique dont l’Algérie a longtemps souffert, pesanteur autoritaire oblige.
L’intérêt de l’ouvrage est d’interroger, au-delà du cadre national, l’arrière-plan maghrébin de ce soulèvement pacifique et d’apporter au passage sa pierre à la théorie des mouvements sociaux. Car, si l’Algérie s’est tenue à distance des « printemps arabes » de 2011, qui avaient secoué le Maroc (avec le Mouvement du 20 février, endigué par l’ajustement constitutionnel de Mohamed VI) et surtout ébranlé la Tunisie (la chute de Ben Ali autorisant une transition démocratique), elle s’est bien rattrapée depuis.
Dans les trois pays, les scénarios politiques sont restés distincts, mais les dynamiques sociétales à l’œuvre partagent de puissants ressorts, en particulier le surgissement de « marges » (périphéries laissées pour compte) travaillées par la tension entre « désir » et « rejet d’Etat ». Le feu a en effet souvent commencé à couver en ces arrière-pays relégués – Gafsa en Tunisie, Ghardaïa en Algérie – comme autant de prodromes. Ou, dans le cas du Rif marocain, des répliques s’y font sentir même quand la fièvre est retombée dans les grandes villes.
Pour autant, le cas du Hirak algérien demeure très singulier. L’un des coauteurs soutient que ce mouvement s’apparente d’avantage à une « révolution de couleur » de type ex-bloc soviétique qu’à un « printemps arabe ». Il faut y entendre que la protestation est de nature foncièrement politique (transparence électorale, « départ du système ») sans que les revendications socio-économiques viennent oblitérer l’agenda. Et, dans ce défi-là, la radicalité de l’exigence se conjugue avec le pacifisme de la méthode, une double caractéristique qui puise dans la mémoire des échecs passés (« printemps berbère » de 1980, émeutes de 1988…). Il s’agit désormais de déjouer les pièges du « système ». D’où le refus du Hirak de se doter d’un leadership afin de prévenir la trop probable décapitation répressive ou, dans sa version douce, la neutralisation par la « cooptation ». D’où, aussi, la quasi-sacralisation de la silmiya (le pacifisme), afin de désarmer la matraque et d’autoriser ainsi la présence massive des femmes et de familles, étoffant d’autant la diversité sociale érigée en bouclier.
Une telle intelligence politique, dont certains s’inquiètent toutefois qu’elle ne s’épuise en impuissance, ne peut venir que de très loin. Le Hirak mobilise le passé et convoque les héros de l’indépendance, ces martyrs « trahis » d’une révolution « confisquée », là encore pour mieux désactiver le logiciel du système. Dans un « effet de réverbération » permanent où l’histoire est « mise en abîme », note un coauteur, « le Hirak et la libération se télescopent dans une temporalité révolutionnaire renouvelée ». « La distance entre le passé et le présent n’est plus, les temps fusionnent ».
Reconstruction de l’image de soi
Car ce dont il s’agit, avec l’abolition d’une telle coupure, n’est rien d’autre que des retrouvailles de l’Algérie avec elle-même. Le pays refait peuple, enfin, après l’aliénation autoritaire qui avait prolongé la dépossession coloniale. Et le Hirak ne se contente pas de proclamer emphatiquement cette réappropriation de soi, il l’éprouve concrètement sur le pavé de la rue Didouche-Mourad en déclinant de « nouveaux types de sociabilité ». Se «
Cette reconstruction de l’image de soi dans une fierté retrouvée est – à n’en point douter – l’incommensurable acquis du Hirak, au-delà des débats tactiques ou stratégiques. On n’a pas fini d’en mesurer l’onde de choc. On la devine seulement à l’émergence d’une conscience nouvelle autour de références jadis taboues ou occultées. Le drapeau amazigh (berbère), que le système veut diaboliser comme un germe de division, est retourné comme une « identité ancestrale et unitaire commune à toute la région [d’Afrique du Nord] ». Et se réconcilier avec le temps, désenclaver l’histoire, c’est aussi réembrasser l’espace, et donc redonner sa place à la diaspora, cette autre « marge » reléguée en lisière de la nation. A Paris, Toronto et ailleurs, le Hirak renoue aussi les fils distendus ou rompus. « Le là-bas et le ici ne deviennent plus qu’un seul espace symbolique. » Certains peuvent s’émouvoir de la chimère « uniciste » que véhicule ce nouvel unanimisme, où sont parfois éludés les sujets qui fâchent. Le temps le dira. Pour l’heure, l’Algérie proteste, et ce n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage que de éclairer le cours de ce mouvement.
L’Année du Maghreb, 2019, vol. II, n° 21, « Quand l’Algérie proteste »
Sous la direction de Thierry Desrues et Eric Gobe, CNRS Editions, 422 pages, 35 euro